Envie d’aider un proche de votre vivant ou de préparer votre succession ? Voici la différence entre donation et legs et faites le bon choix.

Transmettre un bien à un proche, aider un enfant à se loger ou prévoir la répartition de son patrimoine après sa mort : les raisons de vouloir donner de l’argent sont nombreuses. Pourtant, beaucoup confondent donation et legs, alors qu’il s’agit de deux dispositifs juridiques très différents. L’un agit de votre vivant, l’autre après votre décès. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne plus les confondre.
Dans cet article :
La donation : un transfert de propriété de son vivant
La donation est un acte par lequel une personne (le donateur) transfère, de son vivant, la propriété d’un bien à une autre personne (le donataire). Cette opération se fait immédiatement, sans attendre le décès du donateur.
En pratique, il peut s’agir d’une somme d’argent, d’un bien immobilier, d’un meuble de valeur ou encore de parts sociales. La donation permet souvent d’aider un proche — par exemple un enfant — tout en anticipant sa succession.
Dans la plupart des cas, la donation doit être réalisée devant notaire, surtout lorsqu’elle porte sur un bien immobilier. Certaines formes simplifiées existent toutefois : on parle alors de don manuel, lorsqu’il s’agit simplement de remettre une somme d’argent ou un objet en main propre.
Montants maximums exonérés de droits
Chaque parent peut donner jusqu’à 100 000 € par enfant tous les 15 ans, sans payer de droits de donation. Ces abattements s’appliquent également :
- à hauteur de 31 865 € pour les dons aux petits-enfants,
- de 5 310 € pour les arrière-petits-enfants,
- et jusqu’à 80 724 € entre époux ou partenaires de PACS.
À cela peut s’ajouter un abattement supplémentaire de 31 865 € si la donation est un don familial de somme d’argent (le donateur doit alors avoir moins de 80 ans, et le bénéficiaire être majeur).
Attention à la réserve héréditaire
Même si la donation est libre, elle doit respecter la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part du patrimoine qui revient obligatoirement aux héritiers directs. En effet, en France, on ne peut pas déshériter un enfant. Cette part varie selon le nombre d’enfants :
- 1 enfant → il a droit à la moitié du patrimoine.
- 2 enfants → ils se partagent les deux tiers à parts égales.
- 3 enfants ou plus → ils se partagent les trois quarts à parts égales.
Le reste, appelé quotité disponible, peut être librement donné à la personne de son choix.
Avantages de la donation
- Elle permet de transmettre de son vivant, et donc de voir le bénéficiaire en profiter.
- Elle permet aussi de réduire les droits de succession en étalant les donations dans le temps.
- Les abattements fiscaux se renouvellent tous les 15 ans, ce qui offre une réelle souplesse pour gérer son patrimoine.
Attention à l’irrévocabilité
Une fois la donation effectuée et acceptée, elle est en principe irrévocable : on ne peut plus revenir dessus, sauf cas très particuliers (ingratitude du bénéficiaire, non-respect d’une condition, etc.). Il faut donc bien réfléchir avant de se lancer.

VOIR AUSSI : Donations en France : combien peut-on donner de son vivant et à qui ?
Le legs : une transmission après le décès
Le legs, quant à lui, intervient uniquement après le décès du testateur. C’est un acte à cause de mort, c’est-à-dire une disposition qui prend effet grâce à un testament.
Le testateur rédige un document dans lequel il précise à qui il souhaite léguer tout ou partie de ses biens. Le bénéficiaire s’appelle alors le légataire. Contrairement à la donation, le legs ne prive pas le testateur de la jouissance du bien de son vivant.
Trois types de legs existent
- Le legs universel : il concerne l’ensemble du patrimoine.
- Le legs à titre universel : il porte sur une partie du patrimoine (par exemple la moitié des biens).
- Le legs particulier : il désigne un bien précis (par exemple une maison, une voiture, ou un tableau).
Une liberté de modification totale
Le grand avantage du legs, c’est sa souplesse. Tant que le testateur est vivant, il peut modifier ou annuler son testament à tout moment. Il garde donc le contrôle total sur ses biens jusqu’à son décès.
Cependant, le legs doit respecter la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part minimale du patrimoine qui revient obligatoirement aux héritiers directs (enfants, conjoint selon les cas). Si le testament dépasse cette limite, les héritiers réservataires peuvent en demander la réduction.
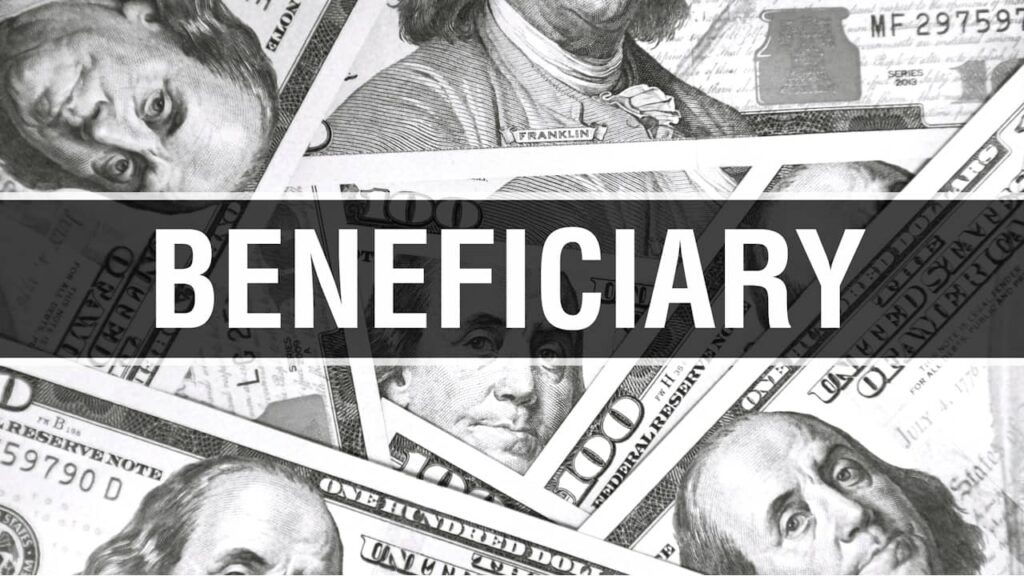
VOIR AUSSI : Succession sans enfant : qui hérite de votre argent ?
Donation ou legs : comment choisir ?
Le choix entre une donation et un legs dépend principalement de votre objectif et de votre situation personnelle.
- Vous souhaitez aider quelqu’un dès maintenant, par exemple financer les études de votre enfant ou lui permettre d’acheter un logement ? → La donation est la solution la plus adaptée.
- Vous préférez rester propriétaire de vos biens jusqu’à la fin de votre vie, tout en décidant à l’avance de leur répartition ? → Le legs, via un testament, sera plus approprié.
Certaines personnes combinent les deux : elles font une donation de leur vivant pour transmettre une partie de leur patrimoine, puis rédigent un testament pour organiser la succession du reste.
En résumé
| Critère | Donation | Legs |
|---|---|---|
| Moment de la transmission | Du vivant du donateur | Après le décès du testateur |
| Forme juridique | Acte notarié ou don manuel | Testament |
| Révocabilité | Non, sauf exceptions | Oui, librement |
| Avantage principal | Aide immédiate à un proche | Organisation de la succession |
| Effet sur la succession | Réduit la masse successorale | Intégré à la succession |
FAQ – Donation ou legs
Oui. Il est tout à fait possible de faire une donation de son vivant pour transmettre une partie de ses biens, puis de prévoir un legs dans son testament pour organiser la succession du reste. C’est même une stratégie souvent utilisée pour optimiser la transmission.
Dans les deux cas, des droits de transmission peuvent s’appliquer, mais des abattements fiscaux existent selon le lien de parenté. Pour la donation, ces abattements se renouvellent tous les 15 ans, ce qui permet d’anticiper et d’alléger la fiscalité globale.
Oui. Un légataire peut toujours refuser un legs, notamment s’il estime que les charges ou dettes attachées au bien sont trop importantes. Il doit alors exprimer son refus formellement auprès du notaire chargé de la succession.
À retenir
La donation est un outil d’anticipation, utile pour transmettre progressivement son patrimoine et aider ses proches de son vivant.
Le legs, lui, permet de prévoir sa succession en toute sérénité, tout en gardant la maîtrise de ses biens jusqu’au bout.
Avant toute démarche, il est recommandé de consulter un notaire pour bien mesurer les conséquences fiscales et successorales de chaque option.
BuzzWebzine est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :








