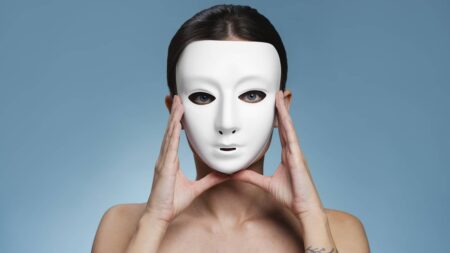Pourquoi une victime s’attache-t-elle à son agresseur ? Plongez dans le mécanisme troublant du syndrome de Stockholm.

Le syndrome de Stockholm est déroutant. Il désigne un phénomène psychologique au cours duquel une victime développe une forme d’attachement émotionnel, voire de sympathie, envers son agresseur. Ce paradoxe intrigue aussi bien les psychologues que le grand public. Mais d’où vient ce mécanisme ? Est-il fréquent ? Et pourquoi survient-il ?
L’origine du syndrome de Stockholm : une prise d’otages en Suède
Le terme « syndrome de Stockholm » a été inventé en 1973 à la suite d’un braquage dans une banque suédoise. Pendant six jours, plusieurs employés furent retenus en otage par deux criminels. À la surprise générale, certains otages se mirent à défendre leurs ravisseurs, allant même jusqu’à refuser de témoigner contre eux au procès.
Le psychiatre Nils Bejerot, mandaté pour accompagner les négociations, fut le premier à mettre des mots sur ce comportement contre-intuitif. Il parla d’une stratégie de survie psychologique, où l’otage s’identifie à son agresseur pour mieux gérer le stress et la peur.
Un mécanisme de défense et de survie inconscient
Le syndrome de Stockholm n’est pas une maladie mentale en soi, mais plutôt un mécanisme de défense inconscient. Il peut survenir dans plusieurs contextes d’abus ou de captivité, pas seulement lors de prises d’otages.
Ce phénomène repose sur plusieurs facteurs :
- Un déséquilibre de pouvoir extrême : la victime est à la merci de son agresseur, ce qui crée une forme de dépendance.
- Une menace constante : la peur de mourir ou d’être blessé pousse le cerveau à trouver des moyens de diminuer le danger.
- Des gestes d’apparente bienveillance : si l’agresseur évite de faire du mal, ou donne à manger par exemple, cela peut être interprété comme un « acte positif », renforçant l’attachement.
- L’isolement : l’absence d’un autre point de repère émotionnel favorise la confusion mentale.
Le syndrome de Stockholm, c’est une forme de réinterprétation du réel où la victime perçoit le ravisseur comme un sauveur potentiel plutôt qu’un bourreau.

VOIR AUSSI : Triangle dramatique de Karpman : êtes-vous victime, persécuteur ou sauveur dans vos relations ?
Les différents contextes du syndrome de Stockholm
On retrouve des formes de syndrome de Stockholm dans plusieurs contextes, notamment :
- Les violences conjugales : certaines victimes défendent leur partenaire violent, minimisent les coups ou rejettent l’aide extérieure.
- Les sectes : les membres, isolés et contrôlés, développent une loyauté extrême envers leur gourou.
- La traite des êtres humains : certaines personnes contraintes à la prostitution peuvent s’attacher à leur proxénète.
- L’éducation coercitive : des enfants maltraités peuvent chercher à plaire à leurs parents violents pour « gagner » leur amour.
Ces situations ont en commun une relation de domination, un isolement et des gestes ambivalents : violence mêlée de récompenses ou de tendresse.
Un processus lent, mais réversible
Le syndrome de Stockholm peut se mettre en place en quelques jours seulement, surtout si l’otage est coupé du monde extérieur. Il n’affecte pas toutes les victimes et reste difficile à prédire.
Heureusement, ce lien toxique peut se déconstruire, souvent grâce à une prise en charge psychologique adaptée. Le rôle de la thérapie est d’aider la personne à reprendre contact avec la réalité, à comprendre ce qu’elle a vécu, et à se libérer de la culpabilité ou de la honte ressentie.

VOIR AUSSI : Le syndrome du sauveur : comprendre ce besoin compulsif d’aider à tout prix
Les affaires qui ont choqué le monde
Plusieurs affaires connues illustrent parfaitement le syndrome de Stockholm, que ce soit dans des prises d’otages, des enlèvements ou des situations de violence prolongée. Voici quelques exemples marquants.
Le braquage de la Kreditbanken (Stockholm, 1973)
C’est l’affaire fondatrice du terme. Le 23 août 1973, Jan-Erik Olsson, un braqueur armé, prend quatre employés en otage dans une banque à Stockholm. Il exige la libération de son complice et de l’argent. L’affaire dure six jours. Contre toute attente, les otages se montrent solidaires avec les ravisseurs, et certains vont refuser de témoigner contre eux.
👉 Fait marquant : une des otages, Kristin Enmark, a même défendu Olsson en public et lui a rendu visite en prison.
L’enlèvement de Patty Hearst (États-Unis, 1974)
Patty Hearst, héritière d’un magnat de la presse, est enlevée par un groupe révolutionnaire, l’Armée de libération symbionaise. Après plusieurs semaines de captivité, elle apparaît dans une vidéo en train de braquer une banque aux côtés de ses ravisseurs.
👉 Elle dira plus tard avoir été endoctrinée et violée, mais certains doutent de la sincérité de sa participation. Quoi qu’il en soit, son comportement s’explique en partie par un syndrome de Stockholm.
L’affaire Colleen Stan (Californie, 1977)
Colleen Stan, 20 ans, est enlevée en auto-stop par un couple. Elle est séquestrée pendant 7 ans, enfermée dans une boîte sous leur lit, violée, battue et manipulée. Son ravisseur la convainc qu’un réseau de surveillance la tuera si elle tente de s’échapper.
👉 Malgré cela, elle développe un attachement à son ravisseur, obéit à ses ordres, et ne s’enfuit pas même quand elle en a l’occasion.
L’affaire Natascha Kampusch (Autriche, 1998-2006)
Enlevée à 10 ans en allant à l’école, Natascha Kampusch est détenue huit ans dans une cave par Wolfgang Přiklopil. Après sa fuite, elle refuse de diaboliser son ravisseur et dit avoir eu « de bons moments » avec lui, suscitant l’incompréhension.
👉 Dans son témoignage, Natascha Kampusch a reconnu avoir ressenti une forme de tristesse à l’annonce du suicide de son ravisseur, malgré les années de captivité. Elle évoque dans son livre un lien ambigu, mêlé de domination, de peur et de dépendance.

VOIR AUSSI : Stop au mansplaining : 6 réponses intelligentes pour ne pas le subir
Violences conjugales et syndrome de Stockholm
De plus, les cas de femmes battues qui défendent leur agresseur sont fréquents. Certaines victimes refusent de porter plainte ou retournent vivre avec leur compagnon violent, même après des hospitalisations.
👉 Cela s’explique par une dépendance affective, une peur de représailles, mais aussi une forme de syndrome de Stockholm domestique.
Ces différents contextes montrent que le syndrome de Stockholm peut toucher n’importe qui, indépendamment de l’âge, du sexe ou de la condition sociale. Il ne faut jamais juger la victime, car ce comportement paradoxal est une réaction de survie, pas un choix conscient.
Le syndrome de Stockholm illustre les ressources incroyables de l’esprit humain pour survivre à une situation extrême. Ce n’est pas un signe de faiblesse ni de complicité, mais une réponse instinctive face à un danger vital. Mieux le comprendre, c’est aussi mieux soutenir celles et ceux qui ont été victimes de violences ou de captivité.
BuzzWebzine est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :